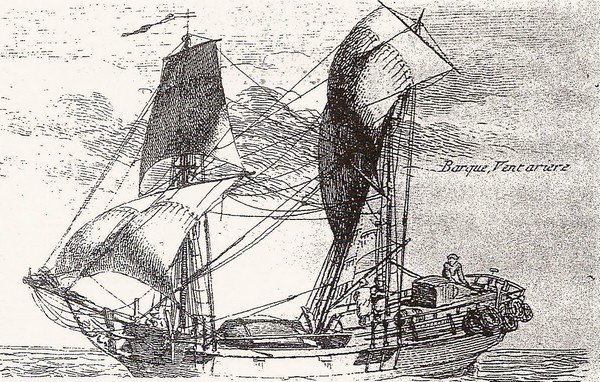Kergadavarn, le 27 octobre 2011.
Un littoral omniprésent, une côte découpée avec de multiples criques, baies ou anses, un aber, une population nombreuse, semblent de prime abord des facteurs favorables à l’implantation de ports commerciaux à Plouguerneau. Effectivement, en remontant dans le temps, on découvre dans le cimetière d’Iliz Koz deux pierres tombales sur lesquelles sont gravées une caravelle à l’ancre et une ancre marine rappelant une certaine vocation marine des habitants du pays. N’oublions pas également la toponymie qui atteste ou laisse supposer l’existence, autrefois, de havres ou de petits ports pour le cabotage, le déchargement du goémon et la relâche de bateaux. On pense, bien entendu, aux Porz Skav (port de l’esquif) ou Porz Doun (port profond). Mais qu’en est-il aux XVIIIe et XIXe siècles ?
L’inventaire de l’amirauté de Léon livre quelques statistiques concernant les mouvements des navires au Korejou au XVIIIe siècle (1). Elles permettent une première approche du trafic portuaire à Plouguerneau. En fait, il existe deux ports à Plouguerneau : le Korejou et Porz Malo. Ce dernier se situe à Lilia. A l’époque on se localise en fonction de son territoire paroissial : on demeure à Plouguerneau ou à Tréménac’h. Il faut savoir que sous l’Ancien Régime toutes les activités maritimes dépendent administrativement de l’Amirauté qui intervient de manière tatillonne auprès des marins se livrant au cabotage.
L’amirauté est présente au Korejou. On y rencontre des huissiers, des maîtres de quais et des commis au greffe. Les compétences de l’Amirauté sont très larges : elle s’occupe de la navigation, du commerce maritime et de tous les faits survenus en mer et sur le littoral. Elle assure la surveillance des chenaux (bouées, balises, obstacles divers), des quais, des digues, des jetées (s’il y en a !). Elle inspecte les navires en cours de construction, délivre les passeports, reçoit les rapports des capitaines au retour d’armement sur lesquels ils consignent leurs remarques sur les incidents survenus et les conditions de navigation. Les chargements et déchargements se font sous son contrôle. Elle délivre les billets de congés sans lesquels aucun équipage ne peut prendre la mer. Le dépôt d’un rôle d’équipage est obligatoire pour obtenir ces congés.
Ce contrôle a un coût. Les populations littorales doivent acquitter des droits de péage pour toute marchandise qui entre ou sort par mer. Le droit de congé est également payant. On ajoutera les droits d’ancrage de trois sous par tonneau, ceux de balisage et de phare (de 30 à 100 tonneaux : 4 à 12 livres ; une livre 10 sous pour les barques et chasse marées de 20 à 30 tonneaux, 8 sous pour les petites embarcations), ceux des enregistrements des déclarations des capitaines, et enfin les droits pour la réception des capitaines. Il faut payer pour obtenir un certificat de jauge lors des constructions, des achats et ventes des navires, pour l’enregistrement des contrats maritimes, des déclarations de construction, des modifications de parts de propriété, pour les rôles d’équipage.
Parfois, l’Amirauté afferme l’entretien des quais et des pieux d’amarrage, procédé courant dans le nord du Léon, à des fermiers, notables ou nobles locaux, qui assurent la « netteté du port, empêchent les bâtiments de décharger leur lest » contre un forfait.
Aussi les professionnels de la mer se voient condamnés à ouvrir régulièrement les cordons de leur bourse contre un droit de « voyerage », pour chaque navire déchargeant ses marchandises, sur le vin, le blé, le sel, le charbon, et à verser trop souvent des droits aux huissiers et aux greffiers ce qui ne peut que rendre ces derniers fortement impopulaires d’autant plus qu’ils sont habituellement étrangers aux régions littorales et même à la Bretagne.
Enfin il existe une dernière catégorie d’individus faisant partie du personnel d’Ancien Régime s’immisçant dans le trafic maritime : ce sont les agents des Fermes du Roi. Regroupés en brigades et commandés par un brigadier, assistés par un sous-brigadier, les gardes (de cinq à dix hommes armés) sont chargés dans leur penthièvre (zone d’intervention), de patrouiller de jour comme de nuit, à pied, à cheval ou dans leur patache (embarcation armée), pour empêcher la contrebande, assurer la surveillance active sur les côtes où pourraient être introduites en fraude des denrées comme le vin, l’eau-de-vie et surtout, ici, le tabac. A l’époque, le tabac ne peut entrer en Léon que par le port de Morlaix et doit revêtir les marques de la Ferme. Il est vendu dans des endroits déterminés où les habitants doivent l’acheter. A Plouguerneau chez l’épouse Faucont Dumont, qui vend aussi de l’épicerie, du savon… Les contrevenants s’exposent à de lourdes amendes de 100 livres, aux galères, puis par la suite au bagne à défaut de paiement ou de récidive.
A Plouguerneau, nous avons retrouvé quelques noms qui témoignent d’une implantation de la Ferme à Kérizoc. Louis Gilet, en 1772, est sous-brigadier tout comme Jacques Queré, en 1787. Julien Visseau porte, en 1781, à Tréménac’h, le titre de commis. En général ces hommes sont haïs de la population et ont mauvaise réputation par leurs comportements contestables, les vexations et les exactions qu’ils commettent sur les populations locales. D’ailleurs, afin d’éviter les connivences entre ces dernières et les fermiers, ceux-ci viennent de contrées étrangères au secteur à surveiller. Mathurin Héraud, en 1776, est originaire de Pontivy.
Mais il est temps de revenir aux statistiques du port du Korejou.
|
Le Koréjou
|
|||
|
1717
|
33
|
||
|
1718
|
29
|
||
|
1719
|
43
|
||
|
1720
|
35
|
||
|
1721
|
27
|
||
|
1722
|
21
|
||
|
1723
|
14
|
||
|
1724
|
13
|
La faiblesse des statistiques disponibles n’empêche pas de constater que le port n’enregistre que de faibles mouvements de bâtiments, d’autant plus que nous ne savons pas si un même navire est comptabilisé à la fois en entrée et sortie, ce qui ne pourrait que diminuer encore l’importance du trafic portuaire.
Indéniablement l’activité maritime du Korejou n’atteint guère les sommets. Pour obtenir un descriptif du port, il est possible de se tourner vers un contemporain : Cambry (2). Il nous relate les conditions d’accès du Korejou, la nature des trafics, les possibilités d’accueil et les directions des flux.
« Le Corréjou : Sa rade a plus d’un quart de lieue de longueur, sur près de trois quarts de lieue de largeur : sa longueur court sur du nord au sud ; et sa largeur d’est à l’ouest : elle est située entre le fort et la longue chaîne de rochers, nommée Carrec-ir. Le fort est assis sur une petite péninsule. La rade a deux entrées. La première entre Carrec-ir et Carrec-croum, s’appelle canal du nord ; elle a 200 pieds de largeur. La deuxième, entre Carrec-croum et le fort, se nomme canal de l’ouest ; il a 120 pieds de large. Le port est au fond de la rade ; sa longueur, de l’est à l’ouest, est d’environ 400 pas ; sa largeur, du nord au sud-est, est de la même étendue. L’entrée du port a 100 pas de large…. Le port du Corréjou peut recevoir des bâtiments de 300 tonneaux, pourvu qu’ils souffrent l’échouage : trente bâtiments caboteurs peuvent s’y trouver à l’aise : la profondeur de la mer, dans les grandes marées, est là de 20 pieds ; d’environ 16 à mer morte.
Le port assèche à toutes les marées. Le fond de la rade est d’herbe et de sable : c’est une relâche sûre pour les convois ; elle peut recevoir environ 70 bâtiments de toute grandeur, des frégates, même dans les mers mortes. La profondeur de cette rade, dans les grandes marées, est de 40 à 50 pieds ; à la mer morte, de 20 à 25.
Le commerce du Corréjou consiste en sel, vins, ardoises, charbon-de-terre, huile et savon : on y chargeait des fûts vides pour Bordeaux, La Rochelle et l’île d’Oléron. »
A travers ce témoignage le port importe surtout des matériaux de construction – ardoises de la région de Châteaulin, pierres, fer, bois, – du sel du sud de la Bretagne pour la conservation des aliments, du vin du sud-ouest français pour les habitants des bourgs côtiers voire de l’intérieur comme Lesneven, du charbon, de l’huile et du savon.
En général, les exportations concernent essentiellement des produits de la terre (lard, beurre, des céréales) à destination du sud-ouest français ou de Brest, gros centre consommateur avec les ouvriers de l’arsenal, les marins, les soldats et sa population civile. On y ajoutera les légumes (poix, fèves) et les futailles vides qui retournent vers le sud-ouest de la France.
Le deuxième enseignement que nous livre Cambry est lié au phénomène des marées et à la relative faiblesse des profondeurs pour accéder au port. Pour pénétrer ou sortir des eaux portuaires, il faut attendre la marée haute ou montante. Il ne paraît pas que le Korejou soit doté d’infrastructures portuaires, aussi on peut penser que les navires sont déchargés à marée basse et que des tombereaux et autres charrettes acheminent les produits vers la terre ferme.
A défaut de précisions sur les tonnages de marchandises, mais en tenant compte des remarques précédentes, il y a fort à penser que le Korejou est un petit port quasi endormi qui ne se réveille qu’épisodiquement avec la venue d’un ou deux caboteurs. Par contre, en période de tempête ou le soir, il n’est pas rare de voir se blottir quelques navires dans sa rade protectrice. En période de guerre, des corsaires et des convois français s’y réfugient également, à l’abri du « fort ». En définitive, une batterie de quelques canons.
Le manque de dynamisme du port est corroboré par les réceptions des capitaines et des maîtres de barques de 1717 à 1790. Seule la paroisse de Tréménac’h enregistre deux réceptions. Pourtant il semble que les conditions d’accès à la maîtrise sont relativement abordables. Il faut avoir 25 ans, accomplir deux campagnes d’au moins trois mois sur les vaisseaux du roi et soixante mois de navigation sur des bâtiments marchands. Mais les dispenses sont nombreuses et le petit concours (devant deux maîtres au cabotage, puis devant un officier de l’Amirauté) paraît accessible à celui qui connaît correctement le mécanisme des marées, les manœuvres d’un navire, la géographie portuaire des zones de cabotages et les règlements royaux.
Dès lors, le défaut de vocations de capitaines et maîtres de barque ne pouvait qu’engendrer une faiblesse de la flottille se livrant au cabotage. On relève rarement les noms de marins au cabotage, tel Y. Le Gal, de Plouguerneau, naviguant sur la Marie-Yvonne entre 1734 et 1741.
Il est clair que le nombre de navires s’adonnant au cabotage est faible voire insignifiant. Et comment pourrait-il en être autrement ? La population locale est massivement paysanne et se tourne vers la terre dans laquelle, quand elle bénéficie de quelques liquidités, elle investit. La bourgeoisie mercantile se limite à quelques unités sans réelle envergure pour placer ses capitaux et les risquer dans l’achat de caboteurs. Cette prudence est vérifiée par le recours au système quirataire familial ou extérieur qui permet la construction et l’armement des bateaux. Chaque parsonnier dispose de parts.
Le sieur Appamon du Derbez en Plouguerneau (1704) a six partenaires, dont le sieur Lisac de Plouguerneau, pour armer l’Anchre. Ce navire transporte du chanvre de Riga, du sel, des amandes, du savon, de l’huile, du vin Tinto. Il se rend régulièrement à Cadix. Par contre, la Marie-Adeline, basée à l’Aber-Benoît, est la propriété du seul O. Nédellec, de Plouguerneau, depuis 1745. Elle jauge 19 tonneaux, est montée par deux hommes qui fréquentent régulièrement le Croisic afin d’y chercher des cargaisons de sel.
Quant aux navires sur lesquels naviguaient nos capitaines et maîtres de barques nous n’avons que peu de précisions. Dans la première moitié du XVIIIe siècle à l’Aber-Wrac’h, 98% des bateaux sont des barques à un ou deux mâts, de formes ramassées. Ils peuvent être pontés. Ils portent « une croix noire en haut de leur mât, comme le font les Bretons en temps de paix et en temps de guerre ». (3) C’est le kroaz du qui remonterait au XIIe siècle et plus sûrement au XVe siècle.
Les barques disposent d’équipages de trois à cinq hommes. Le maître embarque un ou deux matelots et un garçon. Le règlement de 1727 impose un mousse dès que l’équipage se compose de trois hommes et un novice dès qu’un caboteur atteint 25 tonneaux. Le règlement de 1745 oblige à recruter un novice pour quatre hommes d’équipage.
Au Service Historique de la Marine de Brest, les registres des classes présentent quelques hommes, originaires de Plouguerneau, pratiquant le cabotage (le Service des classes, instauré par Colbert deviendra en 1795 l’Inscription maritime). La plupart des matelots, comme Pierre Léon de Plouguerneau, 22 ans, fils de feu Jean et de Jeannette Le Borgne de Saint-Cava ou Yven Léon, 22 ans, de Trévézan (embarqué sur la Notre-Dame des Carmes d’Argenton, en 1782, puis le Marie-Rosaire de l’Aber-Ildut, en 1783, et la Jeune Thérèse du Conquet, en 1785) sont fils de journaliers. Des conditions de vie difficiles, un avenir peu prometteur ou plus prosaïquement le goût de l’aventure, les poussent à choisir le métier de marin.
Ainsi donc le cabotage n’apparaît aucunement comme une activité majeure dans le tissu économique des paroisses de Plouguerneau et de Tréménac’h au XVIIIe siècle. Les explications résident dans l’absence d’un arrière pays digne de ce nom en matière d’échanges. Les acheteurs potentiels se tournent vers des produits de consommation courante comme le sel, le vin ou des matériaux de construction dont la demande n’est pas extensible. Les exportations comprennent essentiellement des céréales et des légumes. Mais il est courant de voir repartir des navires ayant livré leurs cargaisons de vin vers le sud-ouest français, sur lest (avec des fûts vides).
Au XIXe siècle, les améliorations pour la navigation sont réelles en matière de signalisation maritime par l’intermédiaire de la construction d’amers, de bouées, de balises et bien entendu par les phares qui dressent leurs silhouettes à l’île Wrac’h, à Lanvaon, ou encore à l’île Vierge. Quelques efforts, relatifs, sont également enregistrés par l’édification de quais, le long de l’aber-Wrac’h, côtés Plouguerneau et Lannilis, en 1884.
Pourtant le cabotage ne décolle toujours pas à l’inverse du bornage (5) qui comptabilise une cinquantaine de petites embarcations, en 1865, dans le sous-quartier de l’Aber-Wrac’h, dont dépend Plouguerneau, érigé en syndicat. En 1868, sur 25 borneurs recensés, six sont de Plouguerneau, mais 12 de Landéda/l’Aber-Wrac’h. Dans les années 1880, le nombre de bateaux inscrits dans le quartier de l’Aber-Wrac’h, et s’adonnant au cabotage (dont plusieurs langoustiers au mareyage) ne sont que de deux à cinq, selon les années, et une vingtaine pour le bornage.
La faiblesse des immatriculations des bateaux se répercute bien évidemment sur les inscrits maritimes. Les hommes, par la force des choses, boudent toujours les activités de cabotage, mais moins le bornage, comme le démontre, en 1898 le tableau suivant (6) :
|
Quartiers
|
Bornage (inscrits maritime)
|
Cabotage (inscrits maritime)
|
|
Morlaix
|
208
|
397
|
|
Roscoff
|
104
|
54
|
|
L’Aber Wrac’h
|
38
|
6
|
|
Le Conquet
|
119
|
75
|
|
Brest
|
458
|
155
|
Le quartier de l’Aber-Wrac’h arrive en dernière position pour ses effectifs en matière de cabotage et de bornage. Il faut dire qu’à l’époque les inscrits maritimes de Plouguerneau sont rattachés depuis 1892 au quartier de Roscoff. Mais si l’on suit M. Thomassin (7), la situation ne paraît guère plus brillante à Plouguerneau, car pour lui le Korejou « autrefois très fréquenté par les caboteurs est maintenant complètement abandonné ». Même si Mr Thomassin, visite le port dans les années 1860, on peut raisonnablement penser qu’à la fin du XIXe siècle le Korejou est entré, lui aussi en léthargie, lorsqu’on aborde les activités liées au cabotage et au bornage.
En définitive, il faut bien reconnaître que le cabotage aux XVIIIe et XIXe siècles dans le secteur de Plouguerneau n’a pas évolué dans le bon sens et que l’activité est restée marginale.
Les explications sont multiples : un « pays » enclavé et longtemps isolé du reste des forces vives du Léon ; l’absence d’arrière pays économique dynamique qui aurait pu tirer le cabotage et le fortifier par des productions agricoles exportatrices, comme dans la zone légumière de Saint-Pol-de-Léon/Roscoff ; le manque de tradition maritime chez des populations avant tout agricoles ainsi que le défaut d’entrepreneurs désireux d’investir dans le cabotage.
(1) Inventaire de l’Amirauté du Léon. Archives départementales du Finistère.
(2) Cambry J. Voyage dans le Finistère, 1794-1795, Coop Breizh, 1993.
(3) note de J. Darsel à propos de M. Marzault, maître de barque de la Françoise , et originaire de Kerlouan, qui arbore ce drapeau, quand il se fait capturer par les Anglais, en 1570, au large de La Rochelle. La vie maritime et les côtes du Léon sous l’Ancien Régime, BSAF, 1976.
(4) D. Binet, Les pêches côtières de la baie du Mont Saint-Michel à la baie de Bourgneuf au début du XIXe siècle. Ifremer.
(5) Bornage : petit cabotage pratiqué par de petites embarcations de un à trois tonneaux qui assure le transport de marchandises diverses et de passagers. L’équipage comprend de un à trois marins.
(6) D. Binet. Op. Cité.
(7) Mr Thomassin, ancien capitaine de frégate, est un observateur avisé du littoral de la France. Pilotes des côtes de la Manche, T1. Editions du Chasse-Marée, 1984.